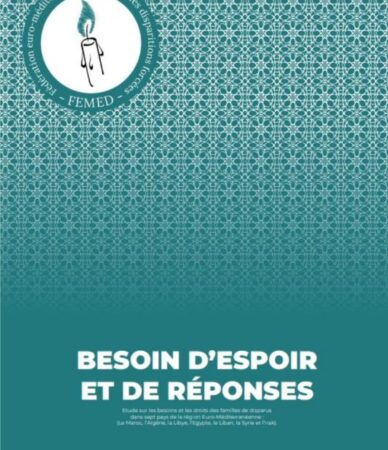« Je veux une réponse ». C’est ce que répondent les familles de disparus quand on les interroge sur leurs besoins. Cette réponse, c’est celle qu’attendent des millions de familles de personnes disparues partout dans le monde.
Dans un contexte géopolitique changeant et un environnement social soumis aux aléas d’une région instable en matière des droits de l’Homme, la FEMED a décidé de de mener une étude sur les besoins des familles vivant au Maghreb et au Moyen-Orient et notamment l’Irak, la Syrie, la Libye, l’Algérie, le Liban, l’Egypte, et le Maroc. L’objectif de cette étude était de réaliser une cartographie des besoins des familles et un état des lieux sur un grand nombre de questions en ayant une vue d’ensemble sur les réponses à ces besoins dans chacun des contextes étudiés. Il s’agissait également d’établir une estimation fiable du nombre de cas de disparitions, en identifiant les caractéristiques principales des disparitions forcées dans chacun des pays. L’étude a également cherché à mesurer la volonté des États à traiter ce dossier, ou leur absence, voire leurs réactions hostiles, mais aussi les contributions et les soutiens obtenus au niveau national et international. Elle a également tenté de compiler les informations accessibles sur les sites où sont enterrées des personnes non-identifiées.
Pour la réalisation de cette étude, la FEMED a recruté un coordinateur de recherche avec lequel elle a établi la méthodologie à adopter pour mener à bien cette étude. Ensuite, une équipe de jeunes chercheurs et chercheuses, presque tous originaires des pays analysés, mais indépendants des associations membres de la FEMED et des associations de familles de disparus, a été recrutée. Cette équipe a été préparée à travers une série de sessions thématiques par vidéo-conférence. Puis, sur une période de deux mois (mai/juin 2021), l’équipe de chercheurs a rassemblé et examiné des sources écrites et disponibles en ligne, pour parvenir à une vue d’ensemble sur les différents sujets liés aux disparitions forcées. Pour cette étude, un questionnaire avec des lignes directrices a été utilisé. Cet outil a permis de constituer un dossier pour chaque pays, tout en mesurant les avancées des chercheurs et en découvrant au fur et à mesure quels étaient les sujets à approfondir.
L’étude de documents s’est complétée par des appels, des échanges en ligne et dans les pays où cela a été possible, par des rencontres avec les familles de disparus, avec les dirigeants de leurs associations, ainsi qu’avec des organisations engagées dans ce même combat. Les assistants de recherche se sont concentrés sur 8 domaines d’action des familles à savoir l’appui humanitaire et administratif aux familles, l’assistance psychosociale, la documentation des dossiers, l’identification et la protection des sites, la recherche urgente, l’enquête et la poursuite judiciaire, le plaidoyer y compris la réparation, la prévention et le travail de mémoire. Parmi ces sujets, il y a les tombes classées x et les charniers en mesurant les capacités de chaque pays à réaliser des exhumations et des identifications en se basant sur des méthodes scientifiques. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, cette étude a contribué à la réflexion stratégique de la FEMED qui, désormais, se donne pour mission de mettre en place un suivi développemental dans chacun des pays étudiés.
En effet, l’étude a réuni des informations essentielles qui permettront à la FEMED de faire des choix ciblés sur ses propres rôles à jouer dans chacun des pays et de se doter des capacités requises à cet effet. Parmi les besoins figurent, par exemple, le renforcement des capacités, la création d’un appui psychologique à destination des familles, la mise en place de mécanismes d’enquête indépendants, la publication d’archives censurées, la ratification de normes internationales ou encore la mise à disposition d’une équipe spécialisée dans le domaine de l’anthropologie médico-légale. Des recommandations sont également faites à l’égard des gouvernements locaux, aux associations et à la communauté internationale. Mener des études dans des pays où la FEMED, à travers ses partenaires, est déployée permet à la fédération de s’imposer dans le domaine de la recherche et d’effectuer des travaux qui seront utiles pour les défenseurs des droits de l’Homme, les étudiants et toute autre personne souhaitant tout simplement s’instruire.
Les 31 juillet et le 1er août de la même année, un atelier de présentation réparti sur deux sessions a été organisé en ligne, via Zoom. L’objectif de cet atelier était de réunir les personnes ayant participé à l’étude et les partenaires de la FEMED afin de présenter le travail de recherche qu’ils ont effectué sur place et de mener une réflexion stratégique relative aux besoins des familles de disparus dans les pays euro-méditerranéens. Le premier jour, Ewoud Plate, coordinateur de la recherche, a présenté l’étude auprès du public. Ensuite, les chercheurs déployés dans les pays concernés se sont relayés pour parler de leurs expériences propres au territoire étudié en exposant leurs méthodologies, les difficultés rencontrées sur le terrain ainsi que leurs résultats. Le deuxième jour, les sujets principaux furent l’anthropologie médico-légale et l’assistance psychosociale.
Parmi les intervenants étaient présents Paul Emanovsky, membre de la Commission internationale des personnes disparues (ICMP), et Omar Battas, membre de l’Association médicale de réhabilitation des victimes de la torture (AMRVT), qui a insisté sur l’importance de surmonter le tabou associé à la santé mentale.
Présenter nos avancements en collaboration avec des chercheurs en s’appuyant sur les différentes étapes de recherche entreprises en rapport avec des cadres spatio-temporels précis permet à la FEMED de diffuser ses domaines de compétences auprès d’autrui.